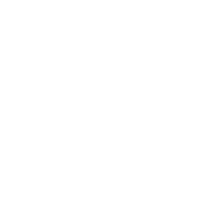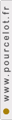Dans le livre Oileáin Árann (éditions Créaphis, 2022), Olivier Gaudin sonde dans son texte Man’s land la lente formation de ce man’s land précaire, à jamais provisoire.
Les îles d’Aran, Irlande, mai 2019
Aran, les pleins et les vides, une île faite main
Mai 2019. Cela faisait trente ans que ce voyage m’attendait. Depuis la découverte d’une petite photographie prise d’avion montrant une des trois îles d’Aran à l’ouest de l’Irlande. Sur cette image, le paysage ressemblait à rien de connu, évoquant davantage un gigantesque dessin déposé au milieu de l’océan. Étrangement striée, la surface minérale de l’ile aux arbres absents était presque entièrement recouverte d’innombrables murets gris organisés en parcelles, comme un pied de nez à l’aléatoire de ses contours escarpés exposés à la violence des vagues.
Atterrir à Dublin, prendre le bus, traverser l’Irlande, embarquer sur le ferry, j’avais choisi de m’approcher de ce territoire lentement, comme s’il fallait à l’un et à l’autre du temps pour la rencontre. Préserver le mystère qu’aucune documentation préalable n’avait réussi à dissoudre.
D’où venait la magie qu’exerçaient sur moi ces quadrillages harmonieux formés par des milliers de murets qui recouvrent l’île comme un filet de pêche aux mailles souples généré par des pratiques ancestrales ? Comme si le cœur granité de l’île devait se parer d’une peau tricotée avec les éclats argentés de son essence même. Une écriture géométrique où se donne à lire, de carrés en rectangles, un alphabet dont le sens, aujourd’hui, s’évanouit. Comme si l’infini de ce territoire inhospitalier balayé par les vents et les embruns, devait inventer un puzzle à compléter afin de détourner le regard du lointain et de ses écumes pour le ramener vers la terre ferme.
Les pièces du puzzle minéral qui forme les murets se ressemblent sans être identiques. Elles s’emboîtent malgré leur densité avec une étonnante légèreté, chacune semble sertie par un travail d’orfèvre. Des murets en pierres sèches qui tiennent tête au vent, à l’opposé des arbres à l’enracinement trop superficiel. L’assemblage se décline en un maillage de pleins et de vides. Ces trous dans l’ouvrage, à première vue incompréhensibles, découpages irréguliers qui donnent à voir le ciel ou la mer, laissent passer les bourrasques et sont maintenus en équilibre miraculeux par l’enchevêtrement savant des pierres.
Des murs faits main, aux signatures reconnaissables par les initiés. Leur différence dans l’agencement des pierres, le soin apporté lors de leur assemblage, le choix de tailler ou de se servir des blocs juste mis grossièrement « au format » pour assurer une unité dans l’alignement du muret, d’infimes signes ou subtilités renseignent sur les propriétaires, et, au milieu des milliers d’enclos, chacun sait lesquels lui appartiennent. Ceux proches des sentiers ou de la route vaguement carrossable sont d’un accès plus facile. Ils permettent de passer d’un enclos minuscule au suivant, des brèches ponctuent la continuité. Ces « gaps », obstrués par de lourdes pierres rondes en granit tacheté, se distinguent souvent par leur couleur plus chaude, ferreuse, du gris-noir calcaire qui imprime la couleur du fond. Autobloqués de façon surprenante, ces blocs doivent être déposés et reposés lors de chaque passage afin d’empêcher l’évasion des quelques vaches, moutons ou du cheval qui tire la charrette pour les touristes.
A l’extérieur du village principale d’Inishmore, la plus grande des trois îles, les habitations dispersées se blottissent entre les murets. Des maisons plus récentes voisinent avec celles avalées par le temps et le déclin démographique, qui laissent entrevoir des traces de la construction traditionnelle. Certaines se sont recouvertes au fil des années d’un manteau fluorescent de lierre vert. Des surfaces de couleur contrastant avec le monochrome de la palette de gris dominante.
Les fortifications fantomatiques de l’âge du fer, conçues pour résister aux envahisseurs, s’abritaient derrière des successions de murs épais en demi-cercles. Ici aucun trou dans l’ouvrage, rien ni personne ne devait pouvoir franchir ces barrières défensives. D’une hauteur et d’une épaisseur de plusieurs mètres, leur force était la masse. Parfois elles étaient précédées de champs immenses constellés d’un inimaginable hérissage d’éclats de dalles posées verticalement en tous sens s’avérant infranchissables pour hommes et chevaux. Des chevaux de frise, que je n’avais croisés que dans le poème éponyme de Guillaume Apollinaire. Les traverser en slalomant, sur un sol lui aussi paré de dalles posées en déséquilibre, exige prudence et attention. Un travail d’Hercule, titanesque, davantage apparenté aux contes ou la série Game of Thrones qu’à une réalité humaine.
Les vagues qui explosent contre les bords abrupts ont la couleur de la pierre sombre et, par marée basse, s’étale un patchwork irrégulier formé par le roux et le vert scintillant des algues et le gris argenté de la pierre moulue par le temps.
Aucun jour sans vent. Il joue les passe-murailles, se faufile entre les pierres, fouette le visage et y dépose son humidité salée. Tandis que le regard, suivant les courbes successives des vagues minérales qui s’étendent à perte de vue, cherche à décrypter ce labyrinthe qui prend la forme d’une partition musicale aux variations infimes, pourtant décelables.
J’étais dos à la mer, le regard et mes sens tournés vers l’intérieur. A force de contempler ces ouvrages sous les variations de la lumière, à me sentir abritée et soutenue comme entre deux serre-livres en pierre, mais jamais emmurée, mes prises de vue ont naturellement adopté la frontalité. Parfois, afin de mieux faire sentir la linéarité dans la succession des fragments, j’ai fini par travailler agenouillée, gardant dans les images une frange de terre pour accentuer l’enracinement du serpent de pierre.
Comprendre que ces murets à taille humaine sont infranchissables, nécessitant d’innombrables détours, est une source d’étonnement. Tenter de les escalader ou de les enjamber délicatement provoque aussitôt un frémissement de la dernière rangée, celle qui repose souvent sur un agencement intégrant des vides. Chaque pierre, masse rugueuse, dense et lourde, défend sa place attitrée. S’appuyer, trouver une prise, une avancée pour poser la pointe du pied, trouble l’équilibre précaire jusqu’à faire chuter en domino des pans entiers. Il arrive que de l’organigramme répétitif émergent des sculptures minérales, dentelles de pierres, qui se maintiennent avec grâce, enfin libérées de leur fonction de clôture, transformées en œuvres naturelles par la violence des éléments et l’absence d’entretien.
La puissance et la magie qui émanent de ces îles s’ancrent pour moi avec évidence dans leur histoire de fabrication : au fil des millénaires, la moindre de ces millions de pierres, transportées, empilées, ajustées, a été touchée par des mains d’homme et de femme. Chacune en porte l’empreinte ADN. Mon immersion dans ces étendues que l’œil explore au rythme de la marche s’était doublée d’une expérience tactile. Comme si le toucher en lien avec le regard menait à une extension des sens et à une perception différente du réel. Le rapprochement, au lieu de rétrécir l’espace, élargissait le monde. Chaque pierre, pourtant minuscule détail d’un vaste paysage, devenait singulière et unique.
Mais déceler l’infinie poésie qui se cache derrière l’étrange ballet minéral demande du temps, exige une disponibilité intérieure. Au fil des jours, mon voyage sur « un champ de rocs nus » (John Millington Synge) s’est mué en une expérience unique du temps minéralisé qui absorbe et densifie, ramène à une matérialité éprouvée par le corps et fait vivre l’écoulement du temps, son battement silencieux.